La ministre de l’Agriculture a passé plutôt tranquillement son baptême du feu pour son premier salon de l’agriculture à Paris où elle nous a accordé une interview. Pour répondre, notamment, aux critiques des défenseurs de l’environnement et aux interrogations de la profession agricole.
C’est à dire : La Loi d’orientation agricole (L.O.A.) adoptée juste avant le salon place l’agriculture comme une activité “d'intérêt général majeur”. Concrètement, que signifie cette avancée pour les agriculteurs français ?
Annie Genevard : Notre agriculture, notre pêche et notre forêt reprendront le rang qui est le leur, celui d’intérêt général majeur de la nation. L’agriculture est également inscrite dans le champ de protection des intérêts fondamentaux de la Nation définis dans le Code pénal. C’est une vraie reconnaissance du métier d’agriculteur, du caractère vital de ce que font les agriculteurs français pour la nation. Avec cette loi, nous affirmons un cap clair, celui de la souveraineté alimentaire, qui doit être atteinte à l’heure des grandes inquiétudes internationales et alors que deux défis historiques s’offrent à nous, celui du renouvellement des générations et celui du changement climatique.

Càd : Vous avez affirmé que ce S.I.A. 2025 était une “édition charnière”. Pour quelles raisons ?
A.G. : Ce 61ème Salon de l’agriculture n’a pas été un salon comme les autres. Il a permis de confirmer sans ambiguïté que les Français, et l’État avec eux, aiment les agriculteurs. Ce rendez-vous entre les Français et ceux qui les nourrissent est avant tout une grande fête populaire. Il fait suite à une année terrible pour la Ferme France et il est aussi le premier rendez-vous après les suffrages des chambres. Je conçois ce salon comme la première pierre d’une ère de reconquête agricole et alimentaire.
Càd : Au sujet du Mercosur qui inquiète la profession, de quels autres moyens de pression dispose la France pour faire basculer l'accord ? Sur quels autres pays comptez-vous pour faire pencher la balance et la France ne se berce-t-elle pas d’illusions dans ce dossier ?
A.G. : Les accords de libre-échange sont bons quand ils sont équilibrés. Ce n’est pas le cas avec le projet d’accord du Mercosur. Nous ne laisserons pas la Commission se jouer des États et faire de l’agriculture la variable d’ajustement. La fermeté française, renforcée par le vote du Parlement, est totale. Ce n’est pas être protectionniste que de vouloir défendre nos intérêts et d’avoir des accords équilibrés et justes. Je ne ménage donc aucun effort pour aller convaincre mes homologues des autres États membres lors de mes rencontres à Bruxelles et comme je l’ai fait avec mon collègue polonais auquel j’ai rendu visite. Ils se sont prononcés contre ce projet. Nous poursuivrons ardemment le travail de conviction.

Càd : L’Office français de la biodiversité (O.F.B.) est attaqué de toutes parts par certains syndicats agricoles. Affirmez-vous votre soutien clair à l’O.F.B. ?
A.G. :Je rappelle que les agents de l’O.F.B. sont des agents de l’État et ne doivent être la cible de personne. Des propos outranciers d’individus isolés, de part et d’autre, ont été prononcés ces derniers mois et doivent cesser. Il est nécessaire de reconstruire des relations pacifiées. C’est le sens de la circulaire que la ministre chargée de la Transition écologique et moi-même avons signée en décembre dernier. Des mesures sont essentielles : la compréhension mutuelle du rôle de chacun, la discrétion de l’arme, irritant majeur, le contrôle administratif unique et la désescalade des tensions par l’usage de caméra piéton notamment.
Càd : Comment concrètement l’agriculture française pourrait-elle être autosuffisante, et à quel horizon ?
A.G. : J’ai annoncé le lancement prochain des conférences de la souveraineté alimentaire. Chaque filière construira son plan pour retrouver sa souveraineté avec l’appui de l’État en se fixant des objectifs de souveraineté, tant en matière de production que d’intrants stratégiques. Mon objectif : mettre tout en oeuvre à très court terme pour que nous soyons souverains dans toutes les filières à horizon dix ans.
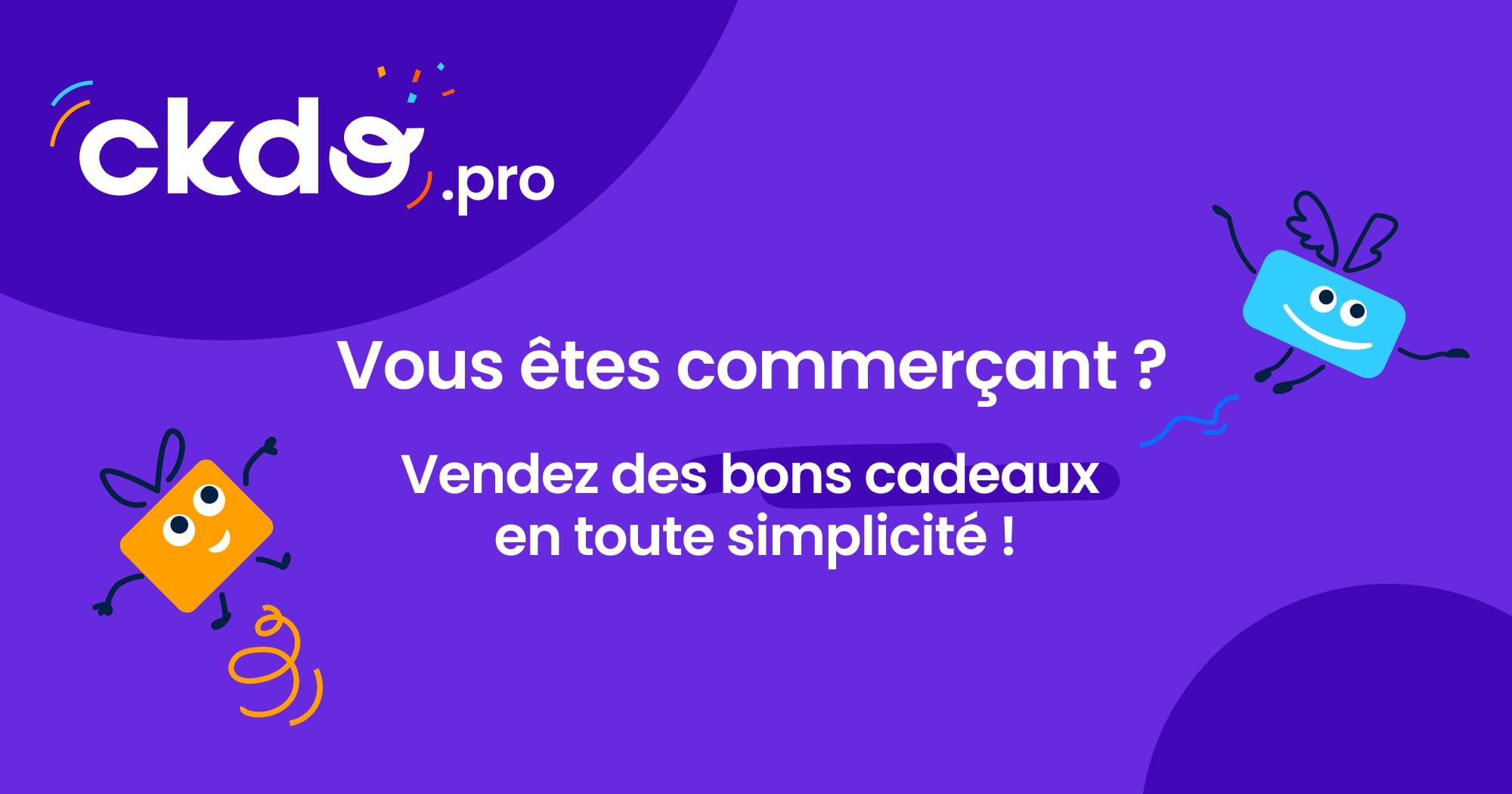
Càd : Vous déplorez que la moitié des fruits et légumes français consommés en France ne soient pas cultivés en France et la moitié des poulets consommés ne soient pas élevés en France. Mais comment peuvent lutter les agriculteurs par rapport aux prix de revient ?
A.G. : Ce sera l’objet des conférences de la souveraineté alimentaire lancées prochainement. C’est aussi un enjeu plus large. Souhaitons-nous laisser une dette alimentaire à nos enfants ? Perdre toute capacité à nourrir notre population ? Pour moi, la réponse est sans appel. Et il en va aussi de la promotion des produits français et de la préférence des consommateurs pour des productions françaises.
Càd : L’article 13 de la L.O.A. entérine une dépénalisation des infractions, ce qui a fait bondir les associations environnementales. Que leur répondez-vous pour les rassurer ?
A.G. : Permettez-moi de rappeler quelques éléments sur ce sujet où la passion l’emporte souvent. La dépénalisation des atteintes non intentionnelles et non définitives à l’environnement était une revendication forte du monde agricole mis face à un certain nombre d’injonctions contradictoires de l’État et à l’inflation normative qui nuit à l’intelligibilité de la loi. Ainsi, mon prédécesseur, Marc Fesneau, s’est emparé du sujet et cette évolution juridique a été inscrite dans le projet de loi à l’Assemblée Nationale. J’ai ensuite défendu cette avancée majeure au Sénat. En effet, les agriculteurs se trouvaient parfois exposés à des injonctions contradictoires : obligations de débroussaillement au regard de la réglementation de prévention des incendies et interdiction de le faire au regard de la réglementation de protection des habitats potentiels d’espèces patrimoniales. Cette insécurité était une source de problèmes insolubles. La loi clarifie : quand il y a une injonction de la loi ou qu’une autorisation administrative est donnée, il ne peut y avoir de poursuites judiciaires. Ainsi, quand nos agriculteurs risquaient peines de prison et amendes de plusieurs dizaines de milliers d’euros rarement appliquées par les juridictions car excessives, pour des atteintes accidentelles à l’environnement, commises sans intentionnalité et de bonne foi, désormais la loi ramène les choses à plus juste proportion : amende réduite ou stage de formation et obligation de remise en état. J’ajoute que cela est tout à fait conforme au droit européen qui ne prévoit que de sanctionner les atteintes volontaires à l’environnement et qui était surtransposé jusque-là. Ce n’est pas pour autant un laisser-faire et un permis de détruire. Il y a toujours, dans tous les cas, l’obligation de réparation et quand les atteintes à l’environnement sont intentionnelles ou définitives, voire commises par négligence grave, les sanctions pénales continueront à s’appliquer avec rigueur. S’agissant des haies, réservoir de biodiversité, la loi simplifie et clarifie le droit pour que leur protection ou leur déplacement soit bien compris de tous et pas seulement des agriculteurs. Pour encourager leur développement, nous avons inscrit 45 millions d’euros en 2025 de manière à maintenir l’ambition de planter 50 000 km de haie nets d’ici 2030.
Càd : Ces mêmes associations dénoncent également une capitulation de la France concernant la réintroduction de certains pesticides. La réglementation européenne en la matière est-elle trop laxiste ?
A.G. : La France a clairement posé le principe d’une réduction des produits phytosanitaires en agriculture. C’est pourquoi mon ministère encourage les instituts de recherche et les instituts techniques à proposer des alternatives à l’utilisation de phytosanitaires, qu’il s’agisse du bio-contrôle, de sélection variétale ou de changements des techniques culturales. Cela porte ses fruits dans certaines productions. En revanche, il demeure des impasses de traitement qui laissent les producteurs exposés à des attaques de ravageurs qui ruinent les récoltes et nous exposent à des importations qui, bien souvent, utilisent lesdits traitements que l’on vient d’interdire en France. C’est absurde et incompréhensible quand sur le même espace de production, l’Union européenne, on autorise des substances interdites chez nous. Les exemples de surtranspositions abondent. Comment croire que les 26 autres États compromettraient délibérément la santé de leurs populations ? Il n’y a rien de choquant à s’aligner sur les autorisations européennes qui sont les plus exigeantes au monde. Pour autant, il y a bel et bien des substances dangereuses pour la santé. Nous devons être très vigilants au sujet des accords de libre-échange conclus avec des pays hors Union Européenne pour ne pas importer des productions traitées avec des produits que l’Europe a interdits depuis bien longtemps.
Càd : Que répondez-vous enfin aux éleveurs du Haut-Doubs traumatisés par les attaques du loup ?
A.G. : Je viens de signer le décret qui assoira juridiquement les tirs de défense que M. le préfet du Doubs sera amené à prendre. Ceci dit, le loup restera toujours une espèce protégée, mais dans le strict respect de l’équilibre avec les éleveurs. On ne peut pas choisir l’un contre l’autre, il faut savoir garder raison sur cette question du loup. C’est une question d’équilibre.
