La députée alsacienne et ancienne ministre Brigitte Klinkert (E.P.R.) a conduit une mission parlementaire dédiée aux problématiques rencontrées par les Français vivant en zone transfrontalière. Avec à la clé, une bonne cinquantaine de recommandations qu’elle compte bien voir menées à bien. Interview.
C’est à dire : Pourquoi avoir initié cette mission flash ?
Brigitte Klinkert : C’est moi qui ai demandé à la commission des affaires étrangères de l’Assemblée nationale de l’initier. Étant une élue d’un territoire frontalier, je me suis rendu compte depuis longtemps que les personnes résidant dans ces territoires frontaliers rencontrent de nombreuses difficultés qui touchent leur quotidien et qui souvent, ont du mal à trouver les bonnes réponses et le bon interlocuteur. J’appelle ça les “irritants transfrontaliers”. Dans des domaines aussi variés que les déplacements, la santé, l’emploi, la formation, le logement… Au moment où je me suis vue confier cette mission, je me suis aperçue que la dernière mission consacrée à ce sujet datait de 2010 et elle ne concernait que la partie franco-allemande. Il était donc temps de se pencher sur cette question plus largement.

Càd : Qu’avez-vous soulevé comme problèmes ?
B.K. :Avant d’aborder les thématiques, je me suis immédiatement rendu compte qu’il y avait une vraie attente sur cette question. La soixantaine de personnes que j’ai auditionnées étaient toutes heureuses qu’on s’intéresse à elles et à leurs problématiques. À tous il semblait que les frontières et tout ce qui en découle semblent très éloignées vu de Paris. La mission que je suis fixée est claire : cerner un maximum de problématiques et y apporter des réponses concrètes dans un délai de 6 mois à un an. Les seules questions que je n’ai pas abordées parce qu’elles relèvent de conventions bilatérales entre pays sont celles relatives à la fiscalité du travail ou à l’indemnisation du chômage.
Càd : Abordons les problématiques que vous avez traitées. Le transport par exemple. Que prônez-vous pour améliorer les choses ?
B.K. :Cette question est récurrente dans tous les territoires frontaliers. Il y a des choses toutes simples à mettre en place comme la création de parkings-relais ou d’aires de covoiturage à proximité des gares. On peut aussi envisager une reconnaissance mutuelle des vignettes écologiques pour les véhicules de l’ensemble des zones frontalières, ce qui n’existe pas. Le soutien de l’État aux projets de lignes ferroviaires régionales transfrontalières paraît aussi primordial. Tout comme l’engagement d’un travail d’harmonisation des critères de recrutement et des exigences techniques pour favoriser la mise en oeuvre de lignes de transport en commun transfrontalières. La S.N.C.F. soit également être sollicitée pour, par exemple, faire figurer dans ses applications mobiles l’ensemble des trajets transfrontaliers et harmoniser leurs tarifs. Il faut aussi demander à la S.N.C.F. de mettre en place une reconnaissance mutuelle des billets en cas de correspondance transfrontalière manquée en raison d’un retard. Une série de mesures très simples à mettre en oeuvre.
Càd : Les questions de santé sont également apparues parmi les thèmes prioritaires ?
B.K. : Une mesure toute simple : permettre aux frontaliers de se faire soigner dans leur pays de travail quand ils n’ont du mal à trouver un rendez-vous en France, pour des examens d’imagerie par exemple. Actuellement, il faut une autorisation préalable de la caisse primaire d’assurance maladie, ce qui est un non-sens. Pour pallier ce problème, il faut juste modifier un arrêté de 2014 pour supprimer l’autorisation préalable. L’assurance-maladie aurait tout à y gagner. Toujours sur le plan de la santé, on pourrait envisager aussi l’élaborer schémas de coordination territoriale transfrontaliers en coordination avec les autorités des pays voisins. Ou encore engager, dans chaque zone transfrontalière, avec l’appui des A.R.S., des discussions pour mettre en place des corridors sanitaires via des conventions entre établissements, filière par filière. Autre sujet très sensible dans ces zones frontalières : il serait opportun de prévoir un dispositif contractuel incitatif ou contraignant les soignants formés gratuitement en France à y travailler plusieurs années, avant de partir en Suisse par exemple. À ce sujet, en Haute-Savoie, une solution amiable a été trouvée avec la Suisse : entre les hôpitaux universitaires de Genève, le canton de Genève, la préfète de Région et l’A.R.S. pour formaliser un “gentleman’s agreement” visant à ce que les hôpitaux universitaires de Genève ne débauchent pas directement ou via leurs mandataires les personnels dans les hôpitaux de la Haute-Savoie et de l’Ain. L’harmonisation des cartes d’invalidité entre les pays est un autre exemple de mesure simple à mettre en oeuvre.
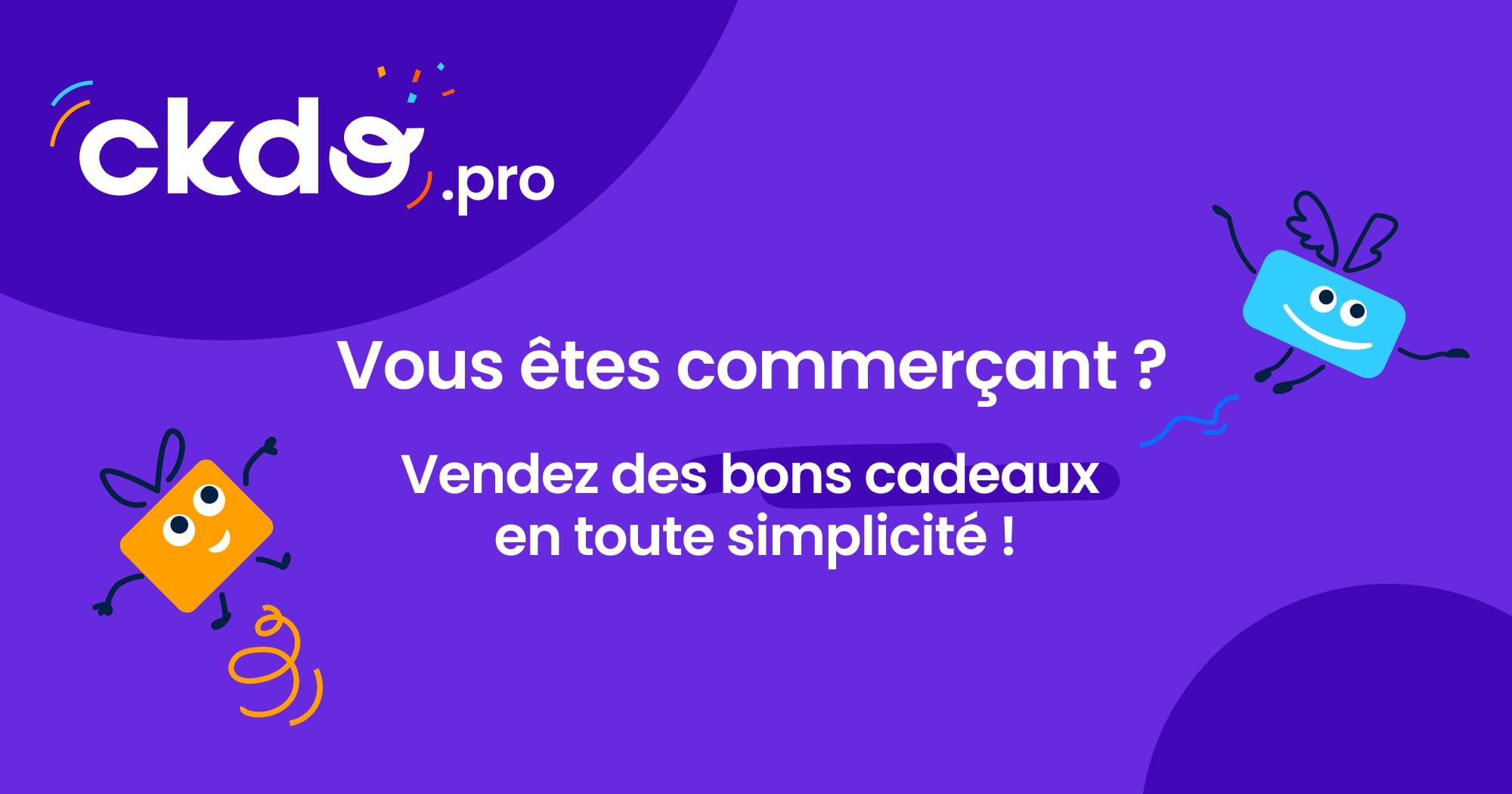
Càd : Le logement, avec la question du foncier et des loyers, est aussi un des points noirs de nos zones transfrontalières. Que proposez-vous pour améliorer la situation ?
B.K. : La première mesure que je prône sur cette question est d’identifier le territoire transfrontalier dans le Code de l’urbanisme, au même titre qu’il l’est pour le littoral ou la montagne en prévoyant l’identification des zones tendues transfrontalières afin de permettre à ces zones de déroger à certaines contraintes législatives et réglementaires pesant sur la gestion du foncier. Clairement, ces zones devraient pouvoir bénéficier de dérogations au Z.A.N., le fameux Zéro artificialisation nette. Je propose aussi de prévoir un mécanisme permettant de collecter auprès des employeurs étrangers l’équivalent du 1 % logement français (qui permet de financer le logement social) lorsqu’ils emploient des salariés français. J’ai fait un autre constat : il arrive fréquemment que les fonctionnaires renoncent au bénéfice de leur concours quand ils sont nommés en zone frontalière à cause du prix des logements. Je propose donc de prévoir la mise à disposition de logements réservés aux fonctionnaires dans ces zones frontalières en tension, tout comme je propose aussi de généraliser la revalorisation de l’indemnité de résidence pour les agents publics exerçant en zone frontalière. De manière générale, je soutiens la possibilité de mettre en oeuvre un mécanisme d’encadrement des loyers dans les zones frontalières tendues.
Càd : Et au chapitre de l’emploi et de la formation, quelles seraient les mesures simples à mettre en oeuvre ?
B.K. : Par exemple dans les filières formant des soignants destinés à exercer dans le pays voisin, prévoir des formations communes cofinancées par le futur pays d’emploi et encourager la création d’instituts de formation mixtes. Ou encore développer des certificats complémentaires reconnus des deux côtés de la frontière pour renforcer l’offre de formations linguistiques spécifiques pour le personnel soignant. Et généraliser les équivalences de diplômes. J’ai l’exemple en tête de ces élèves français privés d’apprentissage de la natation parce que les piscines belges, prêtes à les accueillir, ont des maîtres-nageurs dont la formation n’est pas reconnue par la France. Pour les entreprises, je prône la création d’un statut d’entreprise frontalière pouvant exercer de part et d’autre de la frontière sans recourir aux procédures de détachement.
Càd : Malgré l’existence d’instances de coopération transfrontalière, le dialogue entre les pays frontaliers est encore insuffisant selon vous ?
B.K. : Oui. Je recommande de revenir en profondeur sur l’organisation du dialogue frontalier rendu difficile par les cadres d’organisations territoriales de nos pays. Je pense que l’État français doit être plus présent pour accompagner les usagers, les associations de frontaliers, les collectivités locales. Je soutiens l’idée de désigner dans chaque préfecture de département frontalier un “référent coopération transfrontalière”, qui serait l’interlocuteur unique des associations d’information des usagers et des collectivités. Je propose aussi de développer des maisons France services spécialisées en matière transfrontalière et organiser des permanences des administrations concernées, y compris étrangères. Au niveau gouvernemental, je recommande la nomination d’un secrétaire d’État ou d’un haut-commissaire dédié aux relations transfrontalières pour qu’il existe enfin un point unique d’entrée pour les collectivités locales et leurs partenaires étrangers. Plus globalement, je pense qu’il faut associer davantage les collectivités territoriales et les administrations déconcentrées aux discussions transfrontalières et leur laisser une marge d’initiative pour élaborer des solutions au niveau local dans le cadre prévu par les accords bilatéraux en matière de droit à la différenciation.
Càd : On a vu de nombreux rapports parlementaires finir dans les oubliettes de l’Assemblée nationale. Êtes-vous convaincue que cette mission aboutira à des solutions concrètes ?
B.K. : Je compte bien suivre cela de très près. Toutes les mesures envisagées relèvent du bon sens, c’est du pratico-pratique. Ce qui me fait dire qu’on n’en restera pas là, c’est d’abord ma détermination à voir ces propositions aboutir, mais aussi le fait que le ministre délégué aux Affaires européennes Benjamin Haddad a immédiatement souhaité me rencontrer dès la sortie de ce rapport mi-mars et j’ai senti qu’il avait bien conscience de tous ces soucis à régler. Une chose est sûre : il y a une vraie attente sur ces questions et sur ce dossier, je ne lâcherai rien.
